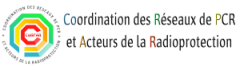Les travaux de la CoRPAR
Données dosimétriques
Pour un plein accès à l’information dosimétrique
Texte acté dans les réseaux régionaux de PCR puis voté unanimement par la Coordination nationale des Réseaux régionaux de PCR lors de sa séance du 10 février 2012.
L’objet de ce texte est de poser le problème de la contradiction entre l’accès très parcellaire‐ pour les PCR ‐ à l’information dosimétrique et leur rôle déterminant en vue de réduire les expositions des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Il en découle une demande forte exprimée unanimement par les PCR.
A l’instar des différentes instances qui se sont exprimées sur le sujet (cf. chapitre IV de l’analyse ci dessous), la Coordination observe qu’il y a une réelle contradiction entre le défaut d’accès à l’information dosimétrique pour les PCR et la mise en oeuvre d’une radioprotection adaptée par ces mêmes acteurs.
Cette situation apparait d’autant plus paradoxale qu’une des missions de la PCR est de produire auprès de l’IRSN l’information relative à la dosimétrie opérationnelle.
La Coordination estime que les données issues du suivi dosimétrique ne peuvent être assimilées à une information diagnostique. Cela vaut pour les résultats d’exposition externe mais aussi pour ceux relevant de l’exposition interne. En effet, la connaissance (par anthropogammamétrie ou radiotoxicologie) d’une contamination interne ‐ en nature isotopique et en activité ‐ renseigne d’abord sur une situation d’exposition que la PCR devra maîtriser sans attendre. Ensuite, elle permet d’effectuer un calcul de dose (volet réglementaire) de la même façon que l’on calcule une dose reçue par exposition externe.
Elle ne constitue donc pas un élément de diagnostic comme peut l’être, par exemple, la recherche d’un marqueur cancéreux chez un patient, information qui, elle, relève clairement du secret médical.
La connaissance des informations dosimétriques permettrait en outre à la PCR de collaborer plus activement et plus rapidement avec le médecin du travail pour optimiser la radioprotection.
La Coordination tient à souligner que la France est isolée dans sa démarche actuelle et que bien d’autres pays démocratiques, attachés au caractère confidentiel des données médicales, n’assimilent pas les informations dosimétriques à une information médicale.
La Coordination est aussi sensible à la crainte, exprimée par des partenaires sociaux, d’une gestion de l’emploi des salariés par la dose.
En conséquence, la Coordination nationale des Réseaux de PCR demande que les PCR puissent avoir un accès, via le système sécurisé de SISERI, à l’ensemble des informations dosimétriques des travailleurs qui les concernent au même titre que le médecin du travail.
La Coordination souhaite donc qu’une modification des dispositions réglementaires actuelles soit engagée en ce sens.
Enfin, dans un tel contexte, la Coordination souhaite que des outils juridiques permettent de renforcer l’indépendance de la PCR, en particulier pour que l’employeur ‐ en‐dehors des situations spécifiques où l’employeur est PCR ‐ ne puisse exiger la transmission des informations de suivi dosimétrique auxquelles il n’a pas droit ; la transmission au travailleur reste de la responsabilité du Médecin du Travail.
Cette prise de position résulte de l’analyse suivante :
I – Accès à l’information dosimétrique
En matière d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, c’est le code du Travail qui définit, d’une part, les valeurs limites réglementaires et, d’autre part, les conditions de la surveillance1 de ces travailleurs exposés ayant notamment pour objet de vérifier le respect de ces valeurs limites. En application de ces dispositions, l’arrêté du 30 décembre 20042 définit les conditions d’accès aux informations dosimétriques.
Cette possibilité de consulter les données dosimétriques est strictement réglementée3. Seul le médecin du travail y a un plein accès, la Personne compétente en radioprotection (un acteur‐clé du dispositif de prévention) n’y ayant qu’un accès très limité.
Le système SISERI centralise les informations des dosimétries passive, interne et opérationnelle ainsi que les résultats des analyses du suivi de la contamination interne des travailleurs en radiotoxicologie et anthroporadiamétrie.
Sous la responsabilité du chef d’établissement, la PCR a un accès direct (via internet) aux valeurs de dose efficace et de dose opérationnelle (uniquement sur les 12 derniers mois) des travailleurs qu’elle suit.
Dit autrement, la PCR n’a pas accès aux valeurs de dose externe, de dose aux extrémités et de dose interne (dose efficace engagée) de ces mêmes travailleurs.
De son côté, le médecin du travail a accès à toutes ces informations dosimétriques.
| Accès | Dose Efficace |
Dose Opérationnelle |
Dose Externe |
Dose Interne |
|
| Travailleurs | Demande écrite | Accès à toute valeur et à l’historique dosimétrique sur demande, réponse sous pli confidentiel. |
|||
| MDT | Direct par Demande écrite |
Accès à toute valeur des 12 derniers mois. Historique dosimétrique sur demande, réponse sous pli confidentiel. |
|||
| PCR | Direct par Internet |
Accès à toute valeur des 12 derniers mois. |
|||
II ‐ Le secret médical
Le secret médical relève du secret professionnel dont l’atteinte est sanctionnée par les dispositions du Code pénal (art. L.226‐13)4. Il s’inscrit dans le droit au respect de la vie privée de toute personne prise en charge par un professionnel de santé. Il n’est pas applicable dans certaines situations5 (i.e. cas de violences physiques ou psychiques).
Les modalités du secret sont précisées dans le code de déontologie médicale6.
La loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, apporte d’importants bouleversements en plaçant le malade au centre de toutes les décisions qui le concernent.
Ainsi, le secret médical n’est pas opposable au patient.
Ce secret peut être partagé. D’abord par une équipe soignante mais aussi par une personne de confiance désignée par le patient (majeur). Cette personne ‐ qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ‐ est désignée par écrit. Elle pourra accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions7.
III ‐ L’objet du débat
En France, ces informations sont considérées comme des données relevant du secret médical ce qui justifierait la stricte confidentialité qui les entoure. Il s’agit là d’une approche spécifiquement française qui fait débat. Dans la plupart des pays étrangers, les informations dosimétriques ne sont pas couvertes par le secret médical.
Pour les uns, cette confidentialité est une garantie contre une dérive possible qui conduirait à une gestion du travail par la dose. Pour les autres, ce déficit d’information constitue un frein à la mise en oeuvre de l’optimisation de la radioprotection.
IV ‐ Les appels au débat
Cette question de l’accès à l’information dosimétrique a déjà fait l’objet de discussions au sein de diverses instances qui, sans aboutir à une position tranchée, ont appelé à un débat sur ce sujet qui concerne tous les milieux de la radioprotection.
1 ‐ Le Groupe de travail issu des GPRAD et GPMED, baptisé GT‐PCR, note dans son rapport final d’avril 2010 :
« Le GT considère que les informations dosimétriques relatives à la dosimétrie externe concernant un salarié ne peuvent être assimilées à une information médicale et par là‐même relever du secret médical. Une telle situation se révèle par ailleurs contre productive sur le plan de la radioprotection et de l’information qui lui est nécessaire pour progresser. Tout en admettant qu’un encadrement réglementaire reste indispensable, et considérant comme primordial l’indépendance de jugement de la PCR évoquée précédemment, le GT souhaite qu’une réflexion ait lieu sur l’accès à l’ensemble des informations dosimétriques. Par contre, le groupe rappelle qu’un examen prescrit par un médecin de manière individuelle ou collective (ce qui est le cas d’un examen radio‐toxicologique urinaire ou anthroporadiamétrique) est régi par le secret médical au terme du code pénal et que, sauf dérogation, le résultat de cet examen ne peut être transmis. »
2 ‐ A l’occasion du débat sur le projet de passeport de dose HERCA (en juin 2010), si certains partenaires sociaux se sont opposés à ce que l’employeur puisse avoir accès à l’information dosimétrique nominative, le COCT8 a néanmoins affirmé :
« Les membres du groupe de travail soulignent que le dispositif réglementaire français, qui ne prévoit pas la transmission de la dose équivalente (extrémités, cristallin) à la personne compétente en radioprotection (PCR) est un obstacle à une bonne radioprotection ».
3 ‐ Ces dernières années, un Groupe de travail du HCTISN9, baptisé GT Transparence et secrets, a conduit une réflexion sur la question de la transparence en matière d’information sur le nucléaire. Le secret médical y a été brièvement évoqué et le rapport final du Haut comité indique :
« Le Haut Comité prend acte qu’il peut y avoir une contradiction entre la protection au titre du secret médical des informations dosimétriques et le suivi et la maîtrise de l’exposition individuelle des travailleurs :
‐ le Haut Comité reconnaît la nécessité d’éviter une gestion de l’emploi des salariés par la dose ;
‐ le Haut Comité reconnaît également la difficulté pour les acteurs de la radioprotection d’assurer le suivi et la maîtrise de l’exposition de chaque travailleur sans les informations dosimétriques. »
Ce commentaire du Haut comité l’a cependant conduit à émettre la « recommandation n°5 » suivante :
« Le Haut Comité recommande qu’une instance de concertation existante ou un groupe de travail pluraliste impliquant toutes les parties prenantes puisse se saisir de ce débat et proposer des recommandations permettant de concilier les différents points de vue.
Le Haut Comité sera intéressé de recueillir les éléments de ce débat.»
V ‐ La position de la Coordination nationale des Réseaux de PCR
La Coordination nationale des Réseaux de PCR, instituée officiellement le 7 octobre 2011, estime être un des acteurs légitime pouvant exprimer le sentiment largement partagé des PCR.
V ‐ 1. Le constat
L’évolution réglementaire dans le temps, qui a précisé et cadré les missions de la PCR, associée à l’évolution des techniques de mesures, font que la PCR, acteur de terrain au plus près des travailleurs exposés, consacre aujourd’hui un temps important ‐ parfois un temps plein ‐ à l’exercice de ses missions. Il s’agit là d’un dispositif spécifique au risque radiologique qui est monté en puissance au cours du temps et a fait ses preuves et qu’il convient donc de conforter en lui donnant les moyens d’exercer ses missions.
Parmi ses missions, la PCR doit s’assurer du respect des limites réglementaires en fonction du classement des travailleurs mais surtout elle est l’acteur‐clé de la mise en oeuvre de l’optimisation de la radioprotection visant à réduire les expositions à un niveau le plus faible possible. Pour ce faire, elle doit conduire (et renouveler régulièrement) des études de poste afin d’évaluer l’exposition des travailleurs. Les données issues du suivi dosimétrique constituent alors une information clé pour la PCR car elles viennent soit valider l’étude de poste soit au contraire révéler des failles dans l’évaluation prévisionnelle d’exposition.
Bien des études de poste peuvent être menées de façon générique. Or, par expérience, les PCR savent fort bien que les expositions individuelles à un même poste de travail peuvent être très différentes d’une personne à une autre et que, par ailleurs, pour un même travailleur des dérives peuvent apparaître au cours du temps. De telles observations sont en particulier flagrantes dans certains secteurs pour ce qui concerne les expositions aux extrémités.
Ce point de vue est le même quelles que soient les voies d’exposition et sans doute plus encore en matière d’exposition interne où, au‐delà du respect des limites de dose engagée, les acteurs de la radioprotection tentent de tout mettre en oeuvre pour éviter tout risque de contamination interne.
Enfin, une directive‐cadre en matière de protection contre les rayonnements ionisants est attendue prochainement. Elle va entériner les dernières recommandations de la CIPR d’avril 2011 ‐ réévaluant le risque radio‐induit de cataracte ‐ en abaissant la limite réglementaire annuelle pour le cristallin de 150 mSv à 20 mSv. Ce point sera probablement le facteur limitant sur certains postes de travail à l’avenir. Alors que c’est bien la PCR qui est concernée au quotidien par ces problématiques, elle n’aura pas, là‐encore comme pour le dosimétrie des extrémités, connaissance de ces informations primordiales.
Il est donc essentiel pour la PCR, dans l’exercice de ces missions, d’avoir accès à l’ensemble détaillé de toutes les données dosimétriques.
V ‐ 2. La demande
A l’instar des différentes instances qui se sont exprimées sur le sujet (cf. chapitre IV), la Coordination observe qu’il y a une réelle contradiction entre le défaut d’accès à l’information dosimétrique pour les PCR et la mise en oeuvre d’une radioprotection adaptée par ces mêmes acteurs.
Cette situation apparait d’autant plus paradoxale qu’une des missions de la PCR est de produire auprès de l’IRSN l’information relative à la dosimétrie opérationnelle.
La Coordination estime que les données issues du suivi dosimétrique ne peuvent être assimilées à une information diagnostique. Cela vaut pour les résultats d’exposition externe mais aussi pour ceux relevant de l’exposition interne. En effet, la connaissance (par anthropogammamétrie ou radiotoxicologie) d’une contamination interne ‐ en nature isotopique et en activité ‐ renseigne d’abord sur une situation d’exposition que la PCR devra maîtriser sans attendre. Ensuite, elle permet d’effectuer un calcul de dose (volet réglementaire) de la même façon que l’on calcule une dose reçue par exposition externe.
Elle ne constitue donc pas un élément de diagnostic comme peut l’être, par exemple, la recherche d’un marqueur cancéreux chez un patient, information qui, elle, relève clairement du secret médical.
La connaissance des informations dosimétriques permettrait en outre à la PCR de collaborer plus activement et plus rapidement avec le médecin du travail pour optimiser la radioprotection.
La Coordination tient à souligner que la France est isolée dans sa démarche actuelle et que bien d’autres pays démocratiques, attachés au caractère confidentiel des données médicales, n’assimilent pas les informations dosimétriques à une information médicale.
La Coordination est aussi sensible à la crainte, exprimée par des partenaires sociaux, d’une gestion de l’emploi des salariés par la dose.
En conséquence, la Coordination nationale des Réseaux de PCR demande que les PCR puissent avoir un accès, via le système sécurisé de SISERI, à l’ensemble des informations dosimétriques des travailleurs qui les concernent au même titre que le médecin du travail.
La Coordination souhaite donc qu’une modification des dispositions réglementaires actuelles soit engagée en ce sens.
Enfin, dans un tel contexte, la Coordination souhaite que des outils juridiques permettent de renforcer l’indépendance de la PCR, en particulier pour que l’employeur ‐ en‐dehors des situations spécifiques où l’employeur est PCR ‐ ne puisse exiger la transmission des informations de suivi dosimétrique auxquelles il n’a pas droit ; la transmission au travailleur reste de la responsabilité du Médecin du Travail.
Références
1 Articles R.4451‐82 à R.4451‐86 du Code du Travail.
2 Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
3 Articles R.4451‐68 à R.4451‐74 du Code du travail.
4 Article L.226‐13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
5 Article L.226‐14 du Code pénal.
6 Voir le site du Conseil de l’ordre des médecins : http://www.conseil‐national.medecin.fr/article/article‐4‐
secret‐professionnel‐913
7 Article L.1111‐6 du Code de la Santé Publique.
8 Commission d’Orientation des Conditions de Travail (commission n°5). Instance consultative placée sous
tutelle de la DGT.
9 Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur le Sécurité Nucléaire. http://www.hctisn.fr
Le livre blanc sur le suivi des expositions
CORPAR / RESEAUX : GROUPES MIROIRS DES ATELIERS DE LA DGT (Juillet 2014)
PREAMBULE
La PCR n’a pas accès direct à toutes les doses en particulier aux valeurs de dose aux extrémités et de dose interne (dose efficace engagée) !…
La coordination s’est autosaisie de ce problème; un document a alors circulé dans les réseaux fin 2011 début 2012 et obtenu l’aval de tous les réseaux.
La CoRPAR a proposé que les PCR puissent avoir un accès, via le système sécurisé SISERI, à l’ensemble des informations dosimétriques des travailleurs qui les concernent au même titre que le médecin du travail (MDT). La CoRPAR souhaite donc qu’une modification des dispositions réglementaires actuelles soit engagée en ce sens.
Enfin, dans un tel contexte, la Coordination souhaite que des outils juridiques permettent de renforcer l’indépendance de la PCR, en particulier pour que l’employeur – en-dehors des situations spécifiques où l’employeur est PCR – ne puisse exiger la transmission des informations de suivi dosimétrique auxquelles il n’a pas droit ; la transmission au travailleur reste de la responsabilité du MDT.
Cette prise de position a été remise à la DGT et est publiée sur ce site.
INITIATIVE de la DGT du Ministère du Travail : le Groupe de Travail sur la surveillance radiologique des travailleurs
La Direction Générale du Travail a créé 1 Groupe de travail s’appuyant sur 4 ateliers techniques pour rédiger un livre blanc de la surveillance radiologique des travailleurs en amont de la transposition de la nouvelle Directive Européenne « Normes de Bases » (59/ 2013). Ces ateliers ont pour objet de répondre aux questions suivantes :
Pourquoi un suivi dosimétrique? Attentes et objectif? (atelier 1)
Quelles techniques pour satisfaire ces objectifs: pour l’exposition externe (atelier 2) et interne (atelier 3)
Quelles données doivent être disponibles? Quel est leur statut? Qui y a accès? (atelier 4)
La CORPAR dans son ensemble s’est constituée en groupe miroir pour discuter des prises de position des GT tant sur le sujet de l’accès aux données que sur d’autres aspects. Mi-juin les ateliers ont commencé à produire des textes de synthèse, 5 réseaux ayant eu leur réunions plénières entre le 15 juin et début juillet se sont constitués en groupes miroirs pour discuter ces projets de synthèses.
Ce qui ressort des 5 groupes miroirs
Ces réunions ont regroupé en tout entre 200 et 220 PCR et acteurs de la radioprotection dont une dizaine de médecins du travail. Les réunions se sont tenues dans quatre réseaux régionaux : APCRAP (PCR seulement médicaux) Centre, ESTRAD, RAMIP (avec présence de PCR et acteurs de la radioprotection de l’industrie) et un réseau sectoriel et régional CNRS/INSERM/Université (PCR recherche)
REACTIONS SUR LES PROPOSITIONS DE DOCTRINE ISSUES DU GT1
1/ Confirmation dans les 5 réseaux de l’existence de travailleurs classés en catégorie B mais non exposés au sens de la Directive Européenne (Code du Travail l’article R4451-46[1], Code de la Santé Publique article R1333-8[2]) et également de non-A, non-B qui sont exposés au sens CIPR de « exposé à un risque dû aux rayonnements ionisants » (Code du Travail l’article R4451-1) exemple du personnel soignant accueillant dans les services de soins des patients ayant eu une administration de radiopharmaceutique, exemple des brancardiers ou des ambulanciers, exemple de nombreux travailleurs de l’aéronautique, exemple des frequent flyers).
Les fréquent flyers sont déjà considérés comme exposés (B) dans plusieurs établissements de l’industrie (RAMIP).
2/ La proposition de définition du travailleur « soumis au risque lié à l’exposition aux rayonnements ionisants» pour couvrir tous ces cas de figure est bien accueillie dans les cinq réseaux,
Un travailleur est considéré comme « soumis à un risque dû aux rayonnements ionisants » dès lors qu’il:
- Entre en zone règlementée du fait de son activité
- Met en œuvre une source de rayonnements ionisants
- Intervient dans des situations d’urgence radiologique ou post accidentelle…
- Est exposé à une concentration de radon supérieure au niveau de référence
- Est exposé aux rayonnements cosmiques dans le cadre de son activité professionnelle
3/ Il y a unanimité pour dire qu’il manque dans la définition du travailleur « soumis… » un cas de figure: « les travailleurs accompagnants de patients «sources » en médical (APCRAP, ESTRAD, Centre) ou des animaux « sources » en recherche. (CNRS/INSERM)»
4/ quid du suivi des non A Non B?
Les premières réactions vont toujours dans le sens de la peur de la complexification, (« mais alors tout le personnel de l’hôpital (ou de l’industrie aéroportée), va être soumis… ; on créé une troisième classe ? svp, NON ; on va devoir suivre tout le personnel de l’installation , on va multiplier par 10 le nombre de dosimètres)
Puis certains pensent qu‘une partie du personnel classé B qui ne devrait pas l’être (surclassé par précaution pour être suivi) ; on pourrait donc dégonfler la classe des B pour les mettre en Non A Non B, parfois appelé C (RAMIP), et les suivre avec de la dosimétrie collective (ambiance) ou calculée lorsque l’étude de poste le permet, voire avec une dosimétrie individuelle, mais sans suivi médical renforcé.
Oui, on continuera à faire des études de poste (tous), on décidera de ne pas classer des travailleurs « soumis » ; on « suivra » donc des travailleurs jusque là non suivis qui ne seront donc plus exclus, et on allégera le « suivi » d’autres travailleurs jusque là classés en B.
Lorsque la discussion dure assez longtemps la notion d’approche graduée fait son chemin.
D’ailleurs dans le domaine de la recherche cela est déjà en cours de réalisation : déclassement et suivi d’ambiance (avec longues explications aux travailleurs un peu inquiets au départ de « n’être plus suivis » ; besoin d’aide à la communication pointé aussi dans le médical) pour des travailleurs qui utilisent des appareils de RX totalement casematés (INSERM) ou même calculé pour des travailleurs soumis à un très faible risque C14 ou H3 (CNRS).
5/ Il y a eu unanimité pour dire qu’il faut former les travailleurs classés et à minima informer les non A non B.
L’utilisation de la dosimétrie collective pour assurer le suivi, ne paraît pas généralisable, mais pas non plus impossible. (Attention à la non homogénéité)
Plutôt que de fournir une liste des personnes soumises aux RI à SISERI une fois par an, pourquoi ne pas ouvrir la FIERI (fiche individuelle exposition aux rayonnements ionisants) aux non A non B ? Réponse: c’est déjà –difficile pour les classés d’avoir des FIERI bien remplies alors…… (ESTRAD)
Refus de fournir des doses ridicules à SISERI pour les non classés (Centre, RAMIP)
La doctrine du GT1 est donc globalement bien accueillie dans les réseaux sollicités
REACTIONS SUR LES PROPOSITIONS DE DOCTRINE ISSUES DU GT4
1/ les présents restent unanimement d’accord (dans les 5 réseaux) avec la prise de position CORPAR de 2012 sur la nécessité pour les PCR de disposer des informations dur les doses équivalentes et les doses internes. Accord de tous les MDT présents (présence dans 3 groupes miroirs)
2/ unanimement les PCR sont favorables à un rapprochement (mais c’est déjà presque partout le cas partout) avec le MDT et tous les acteurs de la prévention.
2.1la charge de travail des MDT et leur faible nombre est pointé du doigt dans plusieurs réseaux.
3/Actuellement l’accès aux données « non autorisées » est très médecin-dépendant d’après les PCR ; la plupart fournissent ces données (y compris interne) soit directement, soit en passant par le travailleur lui même, soit en donnant un accord écrit aux laboratoires fournisseurs de dosimétrie passive (pour les doses équivalentes).
4/ tous les médecins du travail présents (services autonomes) ont confirmé fournir ces informations aux PCR et être hors la loi. Ils ont aussi affirmé ne pas être à même de faire des calculs de dose interne avec les données des examens prescrits. Ils font toujours appel à des experts (PCR, physicien médical, IRSN). Qu’en est il alors des médecins en service interentreprises ?
5/ La prise de position du GT4 pour un accès de la PCR aux doses équivalentes et aux données du suivi de l’exposition interne -avec pour corolaire un accroissement de l’indépendance de la PCR- est bien accueillie.
6/ En ce qui concerne le secret médical pour les expositions internes, la demande est bien sûr qu’il soit levé et que les PCR aient un accès direct aux informations.
7/ Dans aucun des 5 réseaux, la solution qui consiste à mettre la PCR dans le SST, n’est apparue comme une bonne solution pour garantir l’indépendance de la PCR.
En ce qui concerne l’amélioration des relations MT PCR dans les petits services : une suggestion d’une PCR isolée en service de médecine nucléaire privé, avec un MT en interentreprises : rendre obligatoire au moins une réunion annuelle, pour échanger les infos et expériences.
[1] Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu’ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d’entraîner des doses supérieures à l’une des limites de dose fixées à l’article R. 1333-8 du code de la santé publique.
[2] La somme des doses efficaces reçues par toute personne n’appartenant pas aux catégories mentionnées à l’article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.s
Transposition de la nouvelle Directive Européenne « normes de Bases » en radioprotection: implication de la CORPAR (Septembre 2013)
La CORPAR a unanimement pris position en Avril 2012 pour un accès total des PCR aux données dosimétriques afin de remplir totalement leur fonctions. La CORPAR s’est ensuite inquiètée de l’impact des nouvelles limites de dose au cristallin sur la catégorisation des travailleurs. Ces positions ont été transmises aux Administrations concernées.
La DGT a de ce fait invité la CORPAR à participer à une Commission Dosimétrie qui va élaborer un livre blanc sur la dosimétrie-travailleur, ses rôles; ses techniques; les données qu’elle doit produire et ceux qui y ont accès. Ce livre blanc devrait être un apport important pour la transposition de la Directive Normes de Base.
Lettre de mission des GT dosimétrie des travailleurs
5 représentants de la CORPAR étaient présents le 26 septembre 2013 aux côtés des Pouvoirs Publics et des grands exploitants lors de la réunion de lancement de la Commission.
Cette Commission, mise en place par la DGT avec le soutien de l’ASN et de l’IRSN, est présidée par Christine Gauron (INRS) et Pierre Barbey (CORPAR).
En vue d’élaborer ce livre blanc, la DGT a mis en place 4 Groupes de Travail
Le Groupe 1 dirigé par Jean Paul Samain doit réfléchir aux objectifs et aux attentes correspondant à la mise en place d’un sytème dosimétrique. Il s’agit de proposer une politique pour la dosimétrie des travailleurs.
Les Groupes 2 et 3 dirigés par Catherine Roy (Formaveto) et Michèle Gonin (EDF) doivent faire le point sur les techniques dosimétriques, respectivement pour les expositions externe et interne, de façon à voir comment les attentes retenues par le Groupe 1 peuvent être satisfaites.
Le Groupe 4 partira des données dosimétriques pour réfléchir à leur statut, à leur traitement aux acteurs concernés et à l’accès à ces données.
La CORPAR sera présente dans les Groupes de Travail; sa mission y sera de représenter les secteurs médicaux, la recherche et la petite industrie, ainsi que les PCR de tous les secteurs.
La CORPAR a fourni sa prise de position comme un élément initial pour la discussion des Groupes de Travail.